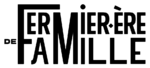Couverture hivernale des sols
Guide 04-03-06
Le contenu qui suit est issu de :
Rédaction : Charlotte Giard-Laliberté, CETAB+
Révision : Jonathan Roy, MAPAQ
Pour contribuer, vous pouvez commenter (en bas de page) ou démarrer une discussion sur le sujet (bouton « … » en haut à droite). Pour modifier le contenu, veuillez contacter les auteur·rices ou écrire à l’équipe du WM. Pour suivre l'évolution de cette page, sélectionnez l'option à cet effet dans le menu "...".
Un réseau de fermes-témoins inspirant
De 2022 à 2024, un réseau de 10 fermes-témoins sur les cultures de couverture en production maraîchère bio et diversifié a été mis en place par la CAPÉ et le CETAB+, sur 7 régions du Québec. Le réseau avait pour objectif de mettre de l’avant des pratiques efficaces et innovantes déjà adoptées par les producteurs à l’avant-garde et d’encourager toute la communauté maraîchère à intégrer des cultures de couverture dans leur rotation. Plusieurs visites de ferme, kiosques de dons de semences, vidéos, formations, ateliers de co-développement et conférences ont été réalisés.
Les 10 fermes témoins étaient : Les Jardins de Sophie (JS), La Terre Ferme (TF), Terra Sativa (TS), la Ferme Croque-Saisons (FCS), la Ferme coopérative Tourne-Sol (FT), la Ferme Cadet Roussel (FCR), les Jardins de Tessa (JT), la Ferme Sanders (FS), la Ferme aux Petits Oignons (FAPO) et les Jardins Beaux-Lieux (JBL).
Les prochaines sections présentent quelques informations utiles tirées des activités du réseau et des fermes témoins.
Notes
- L’abréviation CC est utilisée pour remplacer le terme culture de couverture.
- Les taux de semis utilisés n’étaient pas toujours connus des producteurs et ne sont donc parfois pas précisés.
Présentation des fermes témoins
L’intégration de cultures de couverture ou d’engrais verts pour la protection du sol durant la période hivernale représente un défi pour bon nombre d’entreprises maraîchères biologiques. Les récoltes tardives à l’automne suivies de semis hâtifs au printemps ou simplement l’ajout de travail à une saison déjà bien chargée limitent souvent l’introduction de cultures de couverture hivernale à la ferme.
Dans le but de faciliter l’adoption de stratégies de couverture hivernale, la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ) et le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) ont réalisé un projet de transfert et de diffusion des connaissances sur la couverture hivernale des sols en maraîchage biologique financé par le programme Prime-Vert du ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ).
De 2022 à 2024, un réseau de 10 fermes-témoins sur les cultures de couverture en production maraîchère bio et diversifié a été mis en place par la CAPÉ et le CETAB+, sur 7 régions du Québec. Le réseau avait pour objectif de mettre de l’avant des pratiques efficaces et innovantes déjà adoptées par les producteurs à l’avant-garde et d’encourager toute la communauté maraîchère à intégrer des cultures de couverture dans leur rotation. Plusieurs visites de ferme, kiosques de dons de semences, vidéos, formations, ateliers de co-développement et conférences ont été réalisés.Les 10 fermes témoins étaient : la Ferme Cadet Roussel (FCR), la Ferme Croque-Saisons (FCS), la Ferme coopérative Tourne-Sol (FT), La Terre Ferme (TF), la Ferme Sanders (FS), Terra Sativa (TS), les Jardins de Tessa (JT), la Ferme aux Petits Oignons (FAPO), les Jardins Beaux-Lieux (JBL), Les Jardins de Sophie (JS).
Ferme Cadet Roussel
Tableau 1. Fermoscopie de la Ferme Cadet Roussel
| Région | Montérégie-Est |
|---|---|
| Type de sol | Limon sableux, drainage imparfait |
| Système | Semi-mécanisé |
| Nb d’années en production | 45 ans |
| Superficie cultivée | 7 ha (80-85 % couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La stratégie de la ferme vise à diminuer l’intensité du travail de sol et simplifier l'implantation des cultures de couverture. Une technique propre à la ferme est le semis manuel à la volée dans les cultures maraîchères en croissance, au dernier sarclage. En comparaison à un semis en sol nu avec un semoir à céréales après la récolte des légumes, cette technique permet de sauver les étapes de préparation du lit de semences, ce qui est un avantage notable dans la période chargée des récoltes. Cela permet aussi d’implanter les CC un mois plus tôt, puisque celles-ci sont semées avant la récolte des légumes. De plus, l'entreprise intègre des pâturages de 3 ans dans la rotation avec les légumes.
Coups de coeur
Semis à la volée de seigle d'automne et de vesce velue (150 kg/ha) dans les légumes de conservation (carotte, betterave, rutabaga, panais, radis, endives) de mi-août à septembre
- Semis à la volée de sarrasin, pois et avoine ou blé dans les légumes de saison ou semis à la dérobée
- Semis intercalaires de trèfle blanc seul (10 kg/ha) ou en mélange avec du ray-grass annuel dans les allées des planches avec paillis plastique (maïs, aubergine, poivron, cucurbitacées, oignons, dernières successions de laitues). Environ 5 tontes par saison sont nécessaires.
- CC pleine saison: pois + avoine, blé et/ou triticale (150 kg/ha)
Machinerie
- Semis à la volée: semoir à gazon et à la main (petites superficies) et semoir électrique à la volée Seed Easy de Garber Seeders pouvant semer jusqu'à 6 planches de 4 pieds de large chacune
- Destruction des CC: Broyeur à marteaux Maschio Giraffa de 1,6 m de large et herse à disques
Une des solutions pour ne pas voir les résidus comme une contrainte, c’est de ne pas planifier de semis direct après les cultures de couverture et de plutôt revenir avec une culture transplantée.
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 1 à propos des cultures de couverture à la Ferme Cadet Roussel.
Ferme Croque-Saisons
Tableau 2. Fermoscopie de la Ferme Croque-Saisons
| Région | Estrie |
|---|---|
| Type de sol | Loam |
| Système | Mécanisé sur planche permanente |
| Nb d’années en production | 18 ans |
| Superficie cultivée | 12.25 ha (90-95% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La planification des cultures de couverture est intégrée à celle des cultures maraîchères. Une rotation solide et un plan d’assolement planifié à l’hiver et incluant les CC sont primordiaux pour assurer une bonne gestion des opérations. Beaucoup de mélanges et d’espèces de CC sont utilisés et testés à chaque année sur la ferme afin de maximiser l’intégration des CC dans la rotation. Les CC intercalaires, roulés, pleine saison, vivace, fin de saison, fauchées et récoltées sont toutes des méthodes qui ont été testées à la ferme. Pour les prochaines années, la ferme vise à développer une stratégie de gestion des couverts permettant de limiter les travaux de sol. Les CC, c’est une passion à la ferme et on n’hésite pas à tester de nouvelles stratégies d’intégration des CC et de nouveaux mélanges, toutefois les essais sont toujours réalisés sur des petites parcelles afin de minimiser les risques économiques. L’achat dans les prochaines années d’un semoir permettant le semis direct sous couvert est envisagé.
Coups de coeur
- Seigle de printemps (200 kg/ha), produit plus de biomasse que le seigle d’automne lors des semis tardif et meurt à l’hiver.
- Mélange de vesce commune et de tournesol (total 80 kg/ha) semé au début juillet.
- Mélange de trèfle incarnat et de trèfle rouge semé au début juillet (20 kg/ha).
- Mélange de raygrass et de trèfle rouge semé à partir de la mi-juillet (25 kg/ha).
J’ai l’impression que les gens s’imaginent que les CC c’est compliqué, mais il n’y a pas de raison pour que ce le soit. La première question à se poser c’est pourquoi je veux faire une culture de couverture. La deuxième question, c’est comment je planifie gérer mon couvert. La troisième question, c’est qu’est-ce que je prévois implanter après. Pour commencer, la première étape est d’essayer des choses simples comme le sarrasin, l’avoine et le pois. Si cela ne fonctionne pas sur votre ferme, il y a possiblement un problème avec vos sols.
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 2 à propos des cultures de couverture à la Ferme Croque-Saisons.
Ferme Coopérative Tourne-Sol
Tableau 3. Fermoscopie de la Ferme Coopérative Tourne-Sol
| Région | Montérégie ouest |
|---|---|
| Type de sol | Loam sableux |
| Système | Mécanisé sur planche permanente |
| Nb d’années en production | 18 ans |
| Superficie cultivée | 4.5 ha (80% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La planification des cultures de couverture est intégrée à celle des cultures maraîchères et on prévoit 2 années de CC sur 6 ans de culture dans la rotation. Au quotidien, l’utilisation d'un fichier Excel est primordiale à la bonne gestion des opérations et la validation terrain hebdomadaire permet d'ajuster les travaux au champ selon les conditions météorologiques de chaque saison. L'application de fumier frais est réalisée à la mi-août sur un engrais vert vivant de pleine saison ce qui permet un épandage dans des conditions de sol portant. Après l'enfouissement, une CC d'automne semée à la dérobée permet de valoriser le fumier et de fertiliser la culture maraîchère du printemps subséquent, ce qui sauve du temps. Une technique particulière à la ferme est le roulage du seigle d'automne à l’aide d’un rouleau crêpeur au printemps afin d'effectuer une transition vers une autre CC qui est semée à la volée. À la ferme, la passion pour les CC se fait sentir et on apprécie tester de nouvelles espèces et nouveaux mélanges. Dans l’avenir, la ferme vise à augmenter les rendements afin de minimiser la superficie en culture et maximiser les superficies en CC.
Coups de coeur
- Avoine ou autre céréale (80 kg/ha) + féverole (60 kg/ha) + pois (60 kg/ha) ou vesce commune (40 kg/ha) semis à la dérobée (mi-août à mi-sept). Pas de repousse printanière.
- Seigle d'automne (100 kg/ha) + vesce velue (25 kg/ha) + mélilot (15 kg/ha) semé à la dérobée de mi-août à fin sept. La repousse du printemps est roulée ou fauchée.
- Céréale (80 kg/ha) + ray-grass annuel (25 kg/ha) semé de mi-mai à mi-juin en intercalaire dans les allées et fauché durant la saison
- Prairie vivace (20-30 kg/ha): trèfle blanc et rouge, luzerne, mil, fétuque, ivraie. Semis de début de saison (mi-mai à mi-juin) ou à la dérobée d'une récolte hâtive (mi à fin août).
Machinerie
- Semis: semoir à la volée et à céréales
- Destruction: faucheuse à disques, faucheuse à fléaux, rouleau crêpeur, déchaueuse à disque oblique CAPÉ (gestion des gros résidus), herse à disques tandem, cultivateur lourd-chisel, rotoculteur, vibro, charrue à 3 raies
Avoir plus de surfaces en cultures de couverture, ça allège le fardeau car cela permet d’intégrer plus de parcelles en prairie. Les CC de longue durée sont beaucoup plus faciles à gérer en comparaison aux CC de courte durée, ou il faut intervenir fréquemment et ou la crainte de rater ta chance (son semis) est plus importante.
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 3 à propos des cultures de couverture à la Ferme Tourne-Sol.
La Terre Ferme
Tableau 4. Fermoscopie de la Terre Ferme
| Région | Lanaudière |
|---|---|
| Type de sol | Sable loameux très drainant |
| Système | Mécanisé |
| Nb d’années en production | 25 ans |
| Superficie cultivée | 10 ha (80% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La planification des cultures de couverture est intégrée à celle des cultures maraîchères et est un élément essentiel permettant de faciliter et simplifier la gestion des CC à la ferme. La texture des sols étant très variable, certains des champs doivent être en culture maraîchère à chaque année et sur ceux-ci on tente d’assurer la présence d’une CC à la dérobée en début ou fin de saison. Sur une autre section où on ne manque pas d’espace, le champ est en CC une année sur deux. À la ferme, on vise la simplicité pour les mélanges et on cherche à sélectionner les espèces qui sont adaptées pour les conditions sableuses et sèches du site. Les extrémités de champ et les sections impropres à la culture maraîchère sont semées en prairie et le mélange est fauché et récolté pour la fertilisation des cultures en serre. Dans les prochaines années, la ferme vise à faire l’achat d’un rouleau crêpeur et d’un semoir à céréales en meilleur état, ainsi qu’à identifier le meilleur mélange pleine saison. Afin de maximiser les effets bénéfiques des CC, une rotation incluant 2 années de CC sur 4 sera intégrée dans les champs le permettant. Aussi, l’effet des changements climatiques se fait sentir et on prévoit adapter les dates limites de semis tardif de CC, qui sont repoussées à chaque année.
Coups de coeur
- Mélange 70% pois (115 kg/ha) et 30% avoine ou seigle printemps (30 kg/ha) semé au plus tard au début septembre. Possibilité d’ajouter radis ou moutarde (2 kg/ha).
- Seigle d’automne ou seigle printemps (pas résidus) semé de septembre à début octobre (180 kg/ha).
- Mélange de raygrass (8 kg/ha), de trèfle (3 kg/ha) et de luzerne (4 kg/ha) et mélilot (4 kg/ha) semé en juin-juillet, pour récolter comme EV fauché.
- Prairie permanente de luzerne et de trèfle.
- Vesce velue (40 kg/ha) et seigle d’automne (100 kg/ha)
Il faut tout planifier à l’avance, en hiver, incluant l’achat de semences. Les opérations en lien avec les cultures de couverture sont intégrées au plan de culture qui est ensuite traduit dans un calendrier. Sinon, avec le brouhaha de la saison, les cultures de couverture ne se font pas. Pour ceux qui commencent, ne pas s’aventurer avec des mélanges trop compliqués.
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 4 à propos des cultures de couverture à La Terre Ferme.
Ferme Sanders
Tableau 5. Fermoscopie de la Ferme Sanders
| Région | Estrie |
|---|---|
| Type de sol | Loam sableux, texture très variable |
| Système | Mécanisé |
| Nb d’années en production | 50 ans |
| Superficie cultivée | 20 ha (30-35% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
Les textures de sol variables rendent difficiles l’implantation d’un plan de rotation systématique sur toute la superficie cultivée et le projet est en développement à la ferme. En attendant, la ferme utilise beaucoup de CC à la dérobée. La ferme a la particularité de produire peu de primeurs et fait donc peu d’implantation hâtive. Dans ce contexte, les CC à la dérobée de début de saison sont intéressantes et la ferme teste le pois fourrager pure, qui offre une fourniture en azote intéressante en plus d’un bon contrôle des adventices. Afin d’optimiser le temps de travail et faciliter la gestion des CC, la ferme a fait l’acquisition d’un semoir pneumatique de type APV, qui est combiné à un GPS, une herse rotative et un rouleau, permettant ainsi de faire l’opération de préparation du lit de semences, semis et enfouissement en un passage. La ferme se questionne toutefois sur les bénéfices des CC de courte durée et souhaite à l’avenir faire plus de place aux CC d’une ou plusieurs saisons dans sa rotation.
Coups de coeur
- Mélange 60% d’avoine et 40% de pois semé en juillet.
- Seigle d’automne semé en octobre.
- Mélange d’avoine, de trèfle rouge et de mil semé au début juin.
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 5 à propos des cultures de couverture à la Ferme Sanders.
Terra Sativa
Tableau 6. Fermoscopie de la Ferme Terra Sativa
| Région | Capitale-Nationale |
|---|---|
| Type de sol | Loam sableux (texture très variable) |
| Système | Semi-mécanisé |
| Nb d’années en production | 20 ans |
| Superficie cultivée | 3 ha (10% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La nécessité d’intégrer des cultures de couverture s’étant fait sentir surtout dans les dernières années, la gestion des CC à la ferme est encore en développement. La zone cultivable de la ferme est composée d’une multitude de champs aux textures et formats variables, ce qui rend l’établissement d’un plan de rotation particulièrement difficile. La ferme a toutefois réussi à regrouper les cultures primeurs dans une même parcelle pour faciliter le semis de la CC à la dérobée. De plus, l’utilisation du géotextile tissé comme paillis, essentiel pour la gestion des MH, ajoute des étapes supplémentaires pour le semis de CC à la dérobée en fin de saison. La ferme teste actuellement, avec succès, le semis intercalaire dans les allées des cultures sur paillis tissé, comme le brocoli. La ferme travaille aussi à la mise en culture d’une nouvelle parcelle qui permettra d’intégrer une CC pleine saison dans la rotation.
Coups de coeur
- Raygrass et trèfle incarnat dans les allées des cultures sur paillis tissé
- Le mélange d’avoine pois pour un semis avant la mi-septembre (130 kg/ha)
- Seigle de printemps, vesce commune ou velue, pois et avoine (le mélange varie)
Il est important de mentionner aussi que les cultures de couverture, c’est beau! Lorsqu’on prévoit commencer à intégrer des cultures de couverture, il faut prévoir s’équiper et c’est un aspect non-négligeable.
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 5 à propos des cultures de couverture à la Ferme Terra Sativa.
Ferme aux Petits Oignons
Tableau 7. Fermoscopie de la Ferme coopérative aux Petits Oignons
| Région | Laurentides |
|---|---|
| Type de sol | Sable loameux |
| Système | Semi-mécanisé |
| Nb d’années en production | 18 ans |
| Superficie cultivée | 6 ha (30% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La ferme est encore dans la phase de développement de sa stratégie de gestion des cultures de couverture. L’espace en culture est restreint et jusqu’à récemment, l’absence d’un plan de rotation limitait l’intégration des CC. Maintenant, un plan de rotation principal sur 7 ans prévoit des CC lors des deux dernières années en culture. Un second plan de rotation sur 4 ans pour les primeurs et l’ail permet d’inclure des CC à la dérobée. Le fait d’exclure les primeurs du plan de rotation principal permet d’inclure des CC vivaces ou bisannuelles dans la majorité des parcelles sans être stressé de la repousse au printemps. À la ferme, la gestion des adventices est un enjeu, particulièrement sur les parcelles qui sont aussi cultivées par une ferme voisine en grande culture. Ainsi, il est essentiel que les CC utilisées offrent un excellent contrôle des adventices et aident à diminuer la pression des MH.
Coups de coeur
- Mélange 34% d’avoine, 34% de pois, 8,5% de raygrass annuel, 4,2% de trèfle incarnat et 19% de vesce commune semé en printemps et en été (235 kg/ha).
- Seigle d’automne semé à l’automne (150 kg/ha).
- Mélange d’avoine et de pois semé à la fin de l’été (~150 kg/ha).
Jardins Beaux-Lieux
Tableau 8. Fermoscopie des Jardins Beaux-Lieux
| Région | Bas St-Laurent |
|---|---|
| Type de sol | Loam argileux (texture très variable) |
| Système | Semi-mécanisé |
| Nb d’années en production | 8 ans |
| Superficie cultivée | 2 ha (50% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La ferme a la particularité de cultiver sur un sol lourd et en conditions humides. On vise une stratégie simplifiée, minimisant les coûts et le temps de travail et assurant un bon contrôle des adventices. Le plan de rotation sur 6-7 ans est réfléchi en fonction de la gestion des MH avec les cultures salissantes en fin de rotation, suivies d’une année de CC pleine saison. Les espèces de CC utilisées doivent étouffer les MH efficacement sinon elles ne sont pas conservées. On considère que pour la superficie cultivée, un semoir mécanisé n’est pas nécessaire et tous les semis de CC sont fait à la main, à la volée. La ferme a testé les semis de CC à la dérobée précédant la culture maraîchère, mais la saison courte du Bas-St-Laurent n’est pas propice à cette méthode.
Coups de coeur
- Avoine pois à la dérobée semé avant septembre (200 kg/ha)
- Avoine ou orge semé en septembre (300 kg/ha)
- Tournesol et vesce commune comme mélange pleine saison (total 80 kg/ha)
Pour plus d'information, vous pouvez visionner la vidéo 6 à propos des cultures de couverture aux Jardins Beaux-Lieux.
Jardins de Tessa
Tableau 9. Fermoscopie de la Ferme coopérative Les Jardins de Tessa
| Région | Montérégie est |
|---|---|
| Type de sol | Loam sableux |
| Système | Mécanisé |
| Nb d’années en production | 25 ans |
| Superficie cultivée | 8 ha (75% couvert par des CC en fin de saison) |
Approche
La ferme a la particularité d’intégrer une prairie de trois ans en rotation après trois ans de culture maraîchère. Après la troisième année de culture maraîchère, un seigle d’automne est semé à la dérobée puis le mélange prairial est sursemé à la volée tôt au printemps (sur sol gelé) dans la repousse de seigle. Le seigle est ensuite récolté (grain et paille). La prairie est conservée deux années complètes, puis la troisième année, on laboure et travaille le sol avant de faire un semis à la dérobée d’avoine pois. On considère que cette stratégie nécessite beaucoup moins d’entretien que les CC annuelles. La prairie a aussi de multiples avantages sur la santé des sols en plus de permettre le contrôle des adventices à l’aide la fauche.
Coups de coeur
- Mélange de luzerne, de trèfle rouge, de fétuque et de raygrass
- Avoine (50%) - pois (50%). Le taux est variable en fonction de la date de semis; plus le semis est tardif plus la dose est augmentée. Semé dès qu’une parcelle se libère jusqu’à la mi-octobre
- Seigle semé de septembre à tard à l’automne ( ~200 kg/ha)
Parcelles de démonstration à l'INAB
La section suivante repose sur des données préliminaires collectées lors des essais menés par l'équipe du CETAB+ à l'été 2024. Par conséquent, ces résultats doivent être interprétés avec précaution.
Peut-on détruire un couvert en réduisant l’intensité des travaux de sol ?
Ce sont des questions qui reviennent souvent chez les productrices et producteurs : combien de temps est nécessaire pour détruire une culture de couverture avec une occultation ou une solarisation ? Est-il nécessaire de travailler le sol avant d’installer la bâche ? Peut-on assurer la mortalité d’un couvert prairial avec une occultation ou une solarisation ?
Des parcelles de démonstration ont donc été mises en place à l’INAB à l’été 2024 pour tenter de répondre à ces questions. Différentes combinaisons de travaux de sol et méthodes de recouvrement ont été comparées pour la destruction d’un couvert d’avoine pois et d’un couvert de mélange prairial vivace. Le mélange d’avoine pois a été semé le 16 juin et avait une biomasse d’environ 15 t/ha au début de la destruction. Le mélange prairial a été semé en 2022 et avait une biomasse de 12 t/ha au début de la destruction. Une toile d’ensilage a été utilisée pour l’occultation, une toile de serre pour la solarisation. Des sondes de température du sol ont été installées à 2 cm et 10 cm de profondeur (voir les mesures à la figure 8). Les parcelles ont été occultées/solarisées de la mi-août au début octobre.
Des photos des cultures de couverture après traitement sont présentées aux figures 9 et 10 (destruction d’un mélange d’avoine-pois et d’un mélange prairial). On constate que bien que la solarisation ait permis la décomposition du mélange avoine-pois préalablement fauché ou roulé, les conditions sous la toile de plastique transparent ont été favorables à la croissance de certaines espèces d’adventices. L’occultation après le mélange avoine-pois a permis de bien entamer la décomposition des résidus, particulièrement dans le cas où la CC a été fauchée au préalable, suggérant qu’un travail de sol superficiel suivant l’occultation serait suffisant pour préparer le lit de semences avant le semis. Dans le cas du mélange prairial, la solarisation n’a pas suffi à détruire le mélange peu importe l’opération de gestion du couvert réalisée avant. L’occultation semble avoir été efficace pour détruire la prairie, toutefois on observe encore un épais paillis de résidus à décomposer. Des essais supplémentaires sont nécessaires dans d’autres types de sol et conditions climatiques. Il faut aussi valider l’effet de l’occultation sur la prairie à plus long terme afin de vérifier si une repousse est constatée au printemps. Il est aussi nécessaire de tester la solarisation plus tôt en été dans des conditions climatiques plus chaudes.
Quel mélange choisir pour une culture de couverture pleine saison?
Au total, 25 mélanges de cultures de couverture, observés sur les fermes-témoins, ou conçus par l’équipe du CETAB+, ont été semés à l’INAB dans un dispositif randomisé où chaque mélange était semé sur 2 parcelles de 4 m2 (figure 11). Les cultures de couverture ont été semées le 19 juin 2024 puis la biomasse aérienne a été échantillonnée le 8 septembre. Le champ utilisé avait une forte pression de galinsoga. Des observations sur la vigueur du couvert et la compétitivité face aux adventices ont été réalisées en cours d’été et sont résumées à la figure 11 avec le rendement sec et humide des couverts. Tel qu’observé sur les fermes et illustré dans les photos (page suivante), les mélanges avec tournesol étaient particulièrement impressionnants. Le mélange multi-espèces #9 a été un coup de cœur en raison de sa production de biomasse importante, de sa forte compétitivité avec le galinsoga et des multiples fleurs en mélange. Les mélanges #21 et 24, plus simples, combinant vesce velue et une espèce à forte tige ont aussi été très appréciés. À noter qu’à l’INAB, la vesce velue est fréquemment plus vigoureuse que la vesce commune. Certains producteurs ont toutefois rapporté avoir observé le phénomène inverse sur leur ferme. Il est donc essentiel de tester les mélanges sur plusieurs sites afin de confirmer leur potentiel et de nuancer les résultats en fonction des différents contextes agropédoclimatiques.
Quelle quantité de biomasse peut-on prévoir produire avec un semis de fin de saison?
Afin de répondre à cette question des productrices et producteurs, des semis de cultures de couverture ont été réalisés le 14 août, 27 août et 17 septembre 2024 à l’INAB, afin de comparer la biomasse produite par différentes espèces et mélanges. Les cultures de couverture ont été semées sur des petites parcelles de 4 m2 et chaque combinaison date de semis x espèces a été répétée trois fois dans un dispositif randomisé. La figure 14 présente les moyennes de biomasse aérienne récoltée sur base sèche et humide, en date du 17 novembre 2024, date de début des événements de gels répétés limitant le potentiel de croissance des cultures de couverture. La mi-août représente une date idéale pour un semis de fin de saison. À cette date, on peut encore s’attendre à ce que l’ajout d’une légumineuse en mélange contribue au gain sur la biomasse aérienne produite. On voit que les mélanges avoine-pois avec/sans vesce velue ont obtenu les rendements les plus élevés. Considérant un rendement similaire mais un coût plus élevé pour la semence de vesce velue, l’ajout de cette espèce en mélange à cette date est probablement justifiable dans un cas où la repousse au printemps serait valorisée. Les résultats sont similaires pour le semis fin août. Lorsqu’on compare les semis purs de graminées, l’avoine et le seigle de printemps (mi-août), l’avoine (fin août) ou l’avoine, le seigle d’automne et le seigle de printemps (mi-sept.) ont permis d’obtenir le plus de biomasse aérienne. Encore une fois il est essentiel de refaire ses essais sur plus d’une année et plus d’un site afin de confirmer les résultats.
Ce que dit la science
Tiré de Wilkinson JA et Juteau M. 2025. Intégrer les engrais verts dans les légumes de transformation – le haricot. Fiche technique. CETAB+. Disponible sur le site web du CETAB+.
- L’implantation d’engrais verts et de cultures de couverture est une pratique agricole bénéfique. Cette affirmation, en apparence simple, s’appuie sur plusieurs décennies de travaux scientifiques. Les effets bénéfiques associés à l’utilisation des engrais verts et des cultures de couverture sont multiples et largement documentés dans la littérature scientifique. Nous vous présentons ici les principales conclusions issues de méta-analyses récentes :
- Les cultures de couverture ont un effet positif sur les rendements dans les climats tempérés [1]. L’effet le plus important a été observé avec des légumineuses, suivies par les graminées, les dicotylédones non légumineuses et finalement les mélanges. Globalement, l’effet sur l’amélioration des rendements était de 19 % pour les légumineuses et de 14 % pour les graminées.
- Les cultures de couverture influencent positivement 28 des 38 indicateurs de la santé et de la productivité des sols, regroupés en cinq catégories : indicateurs physiques, chimiques, biologiques, environnementaux et agronomiques [3].
- Les cultures de couverture réduisent le lessivage des nitrates en moyenne de 69 % par rapport à la jachère, tout en n’ayant aucun effet sur le drainage de l’eau. La lixiviation des nitrates a été réduite le plus par les crucifères (-75 %) et les graminées (- 52 %). La réduction du lessivage des nitrates est d’autant plus importante que la teneur en sable du sol est élevée [4].
- Les cultures de couverture améliorent les propriétés microbiennes du sol et augmentent l’abondance (+27 %), l’activité (+22 %) et la diversité (+2,5%) des microbes du sol par rapport à des jachères [5]. Les effets des CC étaient moins prononcés dans certaines conditions, telles que le climat continental, la destruction chimique et le travail réduit du sol.
- Les cultures de couverture augmentent en moyenne le carbone organique des sols jusqu’à 15,5 % selon les études (7,3 % [6], 12 % [7,8], 15,5 % [9]). Elles augmentent le carbone organique des sols dans 59,7 % des observations [10] et constituent ainsi une stratégie prometteuse pour séquestrer le carbone atmosphérique et améliorer la résilience de l’agriculture aux changements climatiques. Les sols à texture fine ont montré la plus grande augmentation de carbone organique des sols (39,5 %), suivis des sols à texture grossière (11,4 %) et à texture moyenne (10,3 %) [9].
- Les cultures de couverture augmentent les émissions de dioxyde de carbone (CO2) mais réduisent les émissions d’oxyde nitreux (N2O) à l’exception des légumineuses qui peuvent également augmenter les émissions de N2O [11,12]. De façon générale, il semble que les CC aient un plus grand potentiel de réduction des émissions de N2O lorsque des espèces non légumineuses sont utilisées et que les résidus de culture ne sont pas incorporés.
- Les cultures de couverture ont le potentiel d’atténuer les impacts des changements climatiques. Le potentiel estimé diffère selon les études, mais il en ressort que l’introduction des CC, grâce à la séquestration du carbone, permettrait de compenser les émissions annuelles directes de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture de 8 % [13] ou de 13 % [14] selon les études citées.
- Les cultures de couverture ont le potentiel de réduire les pertes d’assurance récolte liées aux conditions météorologiques extrêmes [15]. Peu de références sont disponibles sur cet aspect, mais une étude récente réalisée dans le Midwest américain montre que les comtés dans lesquels les CC sont plus répandus ont tendance à enregistrer moins de pertes d’assurance récolte dues à la sécheresse, à l’excès de chaleur et à l’excès d’humidité, suggérant ainsi que les CC peuvent améliorer la résilience aux événements climatiques extrêmes, ceux-ci étaient en augmentation avec les changements climatiques.
Références
- Chahal, I., & Van Eerd, L. L. (2023). Do Cover Crops Increase Subsequent Crop Yield in Temperate Climates? A MetaAnalysis. Sustainability, 15(8), 6517. https://doi.org/10.3390/su15086517
- Bourgeois, B., Charles, A., Van Eerd, L. L., Tremblay, N., Lynch, D., Bourgeois, G., Bastien, M., Bélanger, V., Landry, C., & Vanasse, A. (2022). Interactive effects between cover crop management and the environment modulate benefits to cash crop yields : A meta-analysis. Canadian Journal of Plant Science, 102(3), 656 678. https://doi.org/10.1139/cjps-2021-0177
- Jian, J., Lester, B. J., Du, X., Reiter, M. S., & Stewart, R. D. (2020). A calculator to quantify cover crop effects on soil health and productivity. Soil and Tillage Research, 199, 104575. https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104575
- Nouri, A., Lukas, S., Singh, S., Singh, S., & Machado, S. (2022). When do cover crops reduce nitrate leaching ? A global meta-analysis. Globalchange biology, 28(15), 4736 4749. https://doi.org/10.1111/gcb.16269
- Kim, N., Zabaloy, M. C., Guan, K., & Villamil, M. B. (2020). Do cover crops benefit soil microbiome? A meta-analysis of current research. Soil Biology and Biochemistry, 142, 107701. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107701
- Joshi, D. R., Sieverding, H. L., Xu, H., Kwon, H., Wang, M., Clay, S. A., Johnson, J. M., Thapa, R., Westhoff, S., & Clay, D. E. (2023). A global meta-analysis of cover crop response on soil carbon storage within a corn production system. Agronomy Journal, 115(4), 1543 1556. Wiley Online Library. https://doi.org/10.1002/agj2.21340
- McClelland, S. C., Paustian, K., & Schipanski, M. E. (2021). Management of cover crops in temperate climates influences soil organic carbon stocks : A meta‐analysis. EcologicalApplications, 31(3). https://doi.org/10.1002/eap.2278
- Hu, Q., Thomas, B. W., Powlson, D., Hu, Y., Zhang, Y., Jun, X., Shi, X., & Zhang, Y. (2023). Soil organic carbon fractions in response to soil, environmental and agronomic factors under cover cropping systems : A global meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 355, 108591. https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108591
- Jian, J., Du, X., Reiter, M. S., & Stewart, R. D. (2020). A meta-analysis of global cropland soil carbon changes due to cover cropping. Soil Biology and Biochemistry, 143, 107735. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.107735
- Vendig, I., Guzman, A., De La Cerda, G., Esquivel, K., Mayer, A. C., Ponisio, L., & Bowles, T. M. (2023). Quantifying direct yield benefits of soil carbon increases from cover cropping. Nature Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-023- 01131-7
- Basche, A. D., Miguez, F. E., Kaspar, T. C., & Castellano, M. J. (2014). Do cover crops increase or decrease nitrous oxide emissions? A meta-analysis. Journal of Soil and Water Conservation, 69(6), 471 482. https://doi.org/10.2489/jswc.69.6.471
- Muhammad, I., Sainju, U. M., Zhao, F., Khan, A., Ghimire, R., Fu, X., & Wang, J. (2019). Regulation of soil CO2 and N2O emissions by cover crops : A meta-analysis. Soil and Tillage Research, 192, 103 112. https://doi.org/10.1016/j.still.2019.04.020
- Poeplau, C., & Don, A. (2015). Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops – A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 200, 33 41. https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024
- Schön, J., Gentsch, N., & Breunig, P. (2024). Cover crops support the climate change mitigation potential of agroecosystems. PLOS ONE, 19(5), e0302139. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302139
- Aglasan, S., Rejesus, R. M., Hagen, S., & Salas, W. (2024). Cover crops, crop insurance losses, and resilience to extreme weather events. American Journal ofAgricultural Economics, 106(4), 1410 1434. https://doi.org/10.1111/ajae.12431
Crédits et remerciements
Le réseau de fermes témoins sur la couverture hivernale des sols en maraîchage bio et diversifié est un projet qui a été mené par la CAPÉ et le CETAB+ et financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert.
Nous voulons remercier les personnes suivantes qui ont contribué à la réalisation de ce projet :
- Jean-Baptiste Milesi du CETAB+ pour la réalisation des parcelles de démonstration à l’INAB et la gestion des kiosques de dons de semences;
- Stéphanie Duranceau du CETAB+ pour son aide dans l’organisation des activités de diffusion;
- Lucie Lamarre de la CAPÉ pour son aide dans l’organisation des activités de diffusion;
- Caroline Poirier de la ferme Croque-Saison, pour son aide dans la gestion administrative;
- Sébastien Alix de Ferme Croque-Saison et Reid Allaway de Ferme Tourne-Sol, pour leur contribution à titre de formateurs, conférenciers et pour la rédaction du tableau comparatif sur les espèces de cultures de couverture;
- Johanne Leboeuf de La Terre Ferme, Arnaud Mayet de la Ferme Cadet Roussel, Rock Charpentier de Terra Sativa, Guy Brisebois de la Ferme aux Petits Oignons, Camille Sanders de la Ferme Sanders, Jeffrey Haney des Jardins de Tessa, François Tremblay des Jardins de Sophie et Gabriel Légaré des Jardins Beaux-Lieux pour avoir généreusement pris le temps de partager leurs connaissances et pour avoir ouvert les portes de leur ferme;
- Mélissa Gagnon du MAPAQ Lanaudière, Jonathan Roy du MAPAQ Chaudière-Appalaches, Geneviève Legault du MAPAQ Estrie et Jacques Gagnon du MAPAQ Laurentides, pour leur participation aux rencontres annuelles et aux activités de diffusion;
- Denis La France du CETAB+ pour son mentorat en lien avec les cultures de couverture;
- Anne Weill pour son mentorat en lien avec les cultures de couverture.
Aucun mot clé.