Dépistage
Guide 06-02-01
Le contenu qui suit est issu de :
Weill, A. et J. Duval. (2009). Guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Équiterre.
Pour contribuer, vous pouvez commenter (en bas de page) ou démarrer une discussion sur le sujet (bouton « … » en haut à droite). Pour modifier le contenu, veuillez contacter les auteur·rices ou écrire à l’équipe du WM. Pour suivre l'évolution de cette page, sélectionnez l'option à cet effet dans le menu "...".
Le dépistage est primordial, surtout en ce qui concerne les insectes. La première étape consiste à consulter les avertissements et bulletins du RAP (Réseau d’avertissements phytosanitaires). Grâce à un réseau d’intervenants, les avertissements du RAP permettent de connaître le moment où une maladie ou un insecte commence à être un problème dans la saison, dans une région donnée. Les informations diffusées par le RAP sont utiles à tous les producteurs puisque la date d’apparition et l’abondance des ravageurs varient d’une année à l’autre. Elles donnent aux novices une bonne idée des ravageurs qu’il faut dépister et à quel moment. Un suivi régulier doit être effectué, une à deux fois par semaine. Pour certains insectes, il est possible d’installer des pièges, ce qui permet de connaître plus rapidement le moment de leur apparition. Les pièges collants jaune-orange permettent de dépister la mouche de la carotte et les pièges blancs, la punaise terne. Cette dernière peut aussi être dépistée en frappant les parties de plants privilégiées par la punaise avec un objet dur au-dessus d’un plat de plastique blanc ou noir. Les nymphes de punaises tombent alors dans le plat, et on peut les voir facilement. Il existe des pièges à phéromones pour détecter la teigne du poireau, maintenant très répandue au Québec, et la cécidomyie du chou-fleur. Pour plus d’information sur le dépistage, consulter les bulletins du RAP.
Piège Jackson avec plaquette collante et phéromone pour la cécidomyie du chou-fleur (crédit: M. Gagnon)
Piège Delta blanc avec plaquette collante et phéromone pour la teigne du poireau (crédit: G. Jutras)
Nymphe de punaise terne tombée dans un contenant blanc après une frappe sur une inflorescence (crédit: X. Villeneuve-Desjardins)
En ce qui concerne le dépistage des maladies, il est utile de commencer par examiner les plantes dans les zones humides des champs et dans les baissières, ainsi que les cultivars sensibles. Il faut être particulièrement attentif lors des printemps (mai et juin) humides, car les risques de maladies sont alors élevés.
En agriculture conventionnelle, des seuils au-delà desquels il faut traiter ont été établis. Ces seuils sont assez bas et, en agriculture biologique, on tolère souvent des seuils beaucoup plus élevés.
« Chez nous, il y a une personne qui est spécialisée dans le dépistage. C'est la clé du contrôle des ravageurs. Le dépistage est particulièrement important en serre, car les maladies et les ravageurs évoluent rapidement. Le dépisteur est aussi en charge de commander les prédateurs. Au champ, il est nécessaire de faire une ou deux tournées de dépistage par semaine, selon la température. Il faut bien maîtriser la notion de seuil d'intervention : cela permet beaucoup d'économies. La personne qui dépiste doit avoir des aptitudes et une formation sur les techniques de dépistage. Notre employé a acquis ces techniques grâce au club d'encadrement technique dont nous étions membres. Le RAP est notre référence. »
Aucun mot clé.





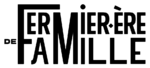


Il n'y a pas une méthode bien définie pour le dépistage sur petite superficie maraichère diversifiée (ex. ferme bio-intensive ou semi-mécanisé). Mon expérience pour un dépistage efficace : - Connaître le calendrier des ennemis des cultures et l’historique de la ferme pour savoir quoi regarder et quand (dépistage sélectif) - Parcourir la zone ciblée (culture) en zigzag et faire un minimum de 5 arrêts (stations) - Dépister 2 à 3 plants par station - Essayer d’avoir des stations réparties le mieux possible et au moins 1 station en début ou fin de rang/planche - Arrêter aux pièges de dépistage - Garder le regard actif en tout temps - Synchroniser le dépistage avec les travaux au champ pour améliorer la fréquence des dépistages à la ferme
Les grandes lignes pour réaliser un bon dépistage sur une superficie légumière uniforme (ex. 1 ha d'un seul légume) : - Suivre un tracé en W (zigzag) - Faire un minimum de 5 arrêts (stations) par parcelle uniforme - Dépister 5-10 plants par station - Varier les stations d’une semaine à l’autre - Garder le regard actif entre les stations - Arrêter aux pièges de dépistage - Dépistage sélectif (station supplémentaire) si foyer d’infestation - Dépister le tour du champ selon la situation (par ex. si faible pression d'un ravageur observé à l’intérieur)
Les pièges collants jaunes sont aussi les plus attractifs pour la mouche du chou (Delia radicum). Pour les mouches des semis, ce sont les pièges collants bleus qui sont le plus efficaces (essai comparatif de pièges testés par Phytodata entre 2014 et 2016).